PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY
Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayCela fait si longtemps qu’il convient de se rafraîchir la mémoire.
Pour la première fois en 12 ans, la Ligue nationale de hockey (LNH) enverra ses joueurs rejoindre la crème de l’élite sportive pour offrir au monde un tournoi olympique des plus prometteurs.
De 1998 à 2014, cela a été la coutume. Il y a eu cinq éditions d’affilée avec les meilleurs joueurs de la planète, cinq compétitions riches en petits et en grands moments de l’histoire sportive.
Non pas que les tournois amateurs eurent déçu. Que ce soit la victoire d’une bande d’universitaires américains contre la machine soviétique en 1980 ou la percée de l’Allemagne éliminée en finale après être passée à quelques secondes d’une médaille d’or en 2018, chaque compétition a laissé son empreinte dans le grand livre.
Il demeure que l’absence des meilleurs ces dernières années avait créé un vide. Leur retour suscite un certain enthousiasme, dirons-nous posément, peut-être même autant que lorsque le hockey sur glace a été inscrit pour la première fois au programme olympique à Anvers, en 1920, pendant les Jeux d’été.
Ce n’est pas faute d’avoir cherché, mais nous n’avons trouvé personne à Radio-Canada Sports pour nous narrer l’événement.
Nagano 1998 : la conquête tchèque, la désillusion canadienne et la ponctualité japonaise
Or, ce que nous avons trouvé, ce sont des journalistes diserts à propos des éditions plus récentes. Un collègue qui a requis l’anonymat – nous l’appellerons donc Fransy Foiçois – a eu le bonheur de couvrir la première participation de la LNH aux JO.
C’était au Japon, le pays des trains ponctuels. Cinq minutes avant que celui qui transportait l’équipe canadienne ne s’arrête en gare à Nagano, le quai était désert, raconte notre mystérieux reporter. Trois minutes avant l’arrivée des joueurs, il était bondé.
Je me souviens avoir levé de terre, raconte-t-il, mimant du même élan cette scène improbable.
La marée humaine, frénétique sur le passage des joueurs, s’en est allée aussi rapidement qu’elle était venue. Et voilà comment s’est amorcée l’aventure olympique des sélections canadiennes.
Que d’émotions! Peut-être encore ébranlés quelques jours plus tard, les Canadiens se sont inclinés en demi-finale devant cette équipe tchèque menée par son gardien, Dominik Hasek, et par l’éternel Jaromir Jagr.
Les Wayne Gretzky, Steve Yzerman, Eric Lindros et Raymond Bourque ont été impuissants devant le brio du gardien tchèque, déjà triple lauréat du trophée Vézina à l’époque.

Wayne Gretzky félicite Dominik Hasek, de la République tchèque, après l'élimination du Canada en demi-finale du tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques de Nagano, en 1998.
Photo : Getty Images / Brian Bahr
Hasek a repoussé 24 des 25 lancers du Canada ainsi que ceux de tous les tireurs pendant la fusillade mémorable qui a couronné les Tchèques, à laquelle n’a pas participé Gretzky, cloué au banc par l’entraîneur Marc Crawford.
Hasek devait par la suite blanchir les Russes en finale, cédant une seule fois contre 48 tirs au cumulatif de ses deux derniers matchs. On se rappelle un peu moins que le Canada s’était ensuite fait battre par la Finlande dans le match pour la médaille de bronze et que les États-Unis avaient aussi été exclus du podium.
Certains joueurs américains avaient d’ailleurs décidé de soulager leur frustration sur le mobilier olympique, rappelant que même les plus grands retours s’accompagnent parfois de bassesses. Au moins, leur train était à l’heure.
2002 : la (re)conquête
La première médaille d’or d’une séquence de trois en quatre pour les Canadiens. Surtout, la première victoire olympique en 50 ans pour le Canada. Les joueurs de la Ligue nationale n’avaient rien à voir avec cette disette, mais il n’empêche que la pression d’y mettre fin leur incombait.
Wayne Gretzky l’a brillamment rappelé dans une conférence de presse inoubliable.
Le tournoi avait bien mal commencé pour les Canadiens, battus 5-2 par la Suède. L’unifolié avait ensuite décroché une courte victoire de 3-2 contre les Allemands et avait fait match nul contre les Tchèques.
La sélection tout étoile a pris son envol à partir des quarts de finale. La plus grande histoire de ce tournoi appartient toutefois aux Bélarusses. Dans un match de quart de finale qui s’annonçait comme un massacre, le Bélarus avait eu raison des Suédois par la marque de 4-3 grâce à un but inespéré du défenseur Vladimir Kopat.
Un lancer frappé de la zone neutre avait trompé le gardien Tommy Salo de façon… inédite.
Selon la légende, encore une fois rapportée par notre journaliste globe-trotteur, présent à l’entraînement des Bélarusses au lendemain de leur victoire, ceux-ci auraient célébré la chose à la hauteur de l’exploit. Pas idéal avant de se mesurer aux Canadiens en demi-finales. Ce fut une victoire facile de 7-1 de la bande à Pat Quinn.
En finale, les Canadiens ont vaincu les Américains sur leur territoire, à Salt Lake City, portés qu’ils étaient par une prestation éblouissante de Joe Sakic et de Jarome Iginla, deux buts chacun. La plus belle réussite de ce match a toutefois été le but de Paul Kariya, marqué à la suite d’une passe fantôme de Mario Lemieux.
Comme quoi la pièce d’un dollar canadien cachée sous la patinoire par le responsable de la glace, originaire d’Edmonton, a fini par porter chance à l’équipe.
Turin 2006 : la déconfiture
Avec tout le respect que l’on doit à Kris Draper, il n’a pas dû être préféré à Sidney Crosby très souvent au cours de sa carrière. Ça lui est arrivé au moins une fois : lors de la sélection de l’équipe olympique canadienne pour les Jeux de Turin, en 2006.
Cela n’a souri à personne. Il y avait dans cette formation un parfum de hockey d’une autre époque. Le directeur général, Wayne Gretzky, avait choisi des vétérans vieillissants au détriment des jeunes vedettes déjà flamboyantes dans la LNH. Crosby, évidemment, mais Eric Staal et Jason Spezza aussi avaient été écartés.
Cette année-là, Crosby, Staal et Spezza avaient amassé 292 points dans le circuit Bettman. Draper, Shane Doan et Ryan Smyth : 164. En défense, Robyn Regehr et Wade Redden avaient aussi été de l’aventure.
Au tour préliminaire, le Canada avait battu l’Italie, l’Allemagne et la République tchèque, mais il avait plié l’échine contre la Finlande et la Suisse ainsi que son bourreau en résidence, Paul DiPietro, l’ancien du Canadien, auteur des deux buts de la rencontre.
La défaite avait relégué l’équipe canadienne au 3e rang de son groupe et lui avait valu un affrontement contre les Russes en quarts de finale, également perdu au compte de 2-0. En six matchs, le Canada avait été blanchi trois fois. Catastrophe en Amérique du Nord puisque les Américains avaient eux aussi été promptement expulsés de la compétition. Finale de rêve en Europe entre la Finlande et la Suède, les deux ennemis jurés, remportée par les Suédois avec un but gagnant du légendaire Nicklas Lidstrom.
Vancouver 2010 : le but en or
Difficile de passer à côté.
Il y a eu d’autres belles histoires dans le tournoi, dont cette présence des Slovaques en demi-finales, mais le but en or demeure l’événement marquant de cette édition des JO, à côté des images d’Alexandre Bilodeau triomphant en bas de Cypress Mountain, de Joannie Rochette en larmes sur la patinoire et de Charles Hamelin, couronné au 500 m, sautant dans les bras de Marianne St-Gelais, couple chéri des Québécois pendant plusieurs années.
Sidney Crosby, cette fois-là bien présent, a inscrit le but gagnant de la finale olympique contre les États-Unis après avoir intimé poliment à Jarome Iginla de lui remettre le disque. Ce glorieux fait d’armes ne se serait jamais produit si le Canada n’avait pas laissé filer une avance de deux buts à mi-chemin dans le match et, surtout, si Zach Parise n’avait pas créé l’égalité avec 25 secondes à jouer en troisième période.
À ce moment, les Canadiens auraient pu avoir le moral dans les talons. Que nenni, nous a assuré Patrice Bergeron il y a quelques années.
On le voit souvent quand tu te fais égaliser en fin de match : tu perds un peu le momentum, ton jeu descend. C’est l’expérience des plus vieux qui nous a vraiment aidés. On est rentrés dans le vestiaire avant la prolongation. Et on s’est dit que si on nous avait dit au début du tournoi qu’on se rendrait en prolongation en finale, on aurait tous été extrêmement contents d’être là. Maintenant, il s’agit juste d’aller jouer et de se faire confiance, de ne pas commencer à stresser parce qu’on a perdu l’avance à la fin du match, avait raconté le Québécois.
J’ai senti qu’on était en contrôle malgré tout. Malgré toute la pression, malgré les embûches, j’ai toujours eu le sentiment que c’était en contrôle, qu’on savait où on s’en allait et qu’on allait trouver un moyen, avait-il ajouté.
Ce qui aurait pu devenir un effondrement historique s’est transformé en un des grands moments du sport canadien et du hockey aux Jeux olympiques en général.

Sidney Crosby aux Jeux de Vancouver en 2010.
Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson
Sotchi 2014 : la démonstration de force canadienne
Un tournoi sans bavure pour le Canada. Six matchs, six victoires, seulement trois buts accordés au passage. Bien des observateurs, à l’époque, avaient affirmé qu’il s’agissait là de la meilleure équipe défensive jamais assemblée, qui misait de surcroît sur un certain Carey Price.
Le portier du CH, au faîte de sa gloire, avait maintenu des statistiques irréelles : une moyenne de 0,59 et un taux d’efficacité de ,972.
Le parcours n’avait pas été de tout repos pour autant. En quarts de finale, le Canada avait buté sur Kristers Gudlevskis, un gardien letton, lointain choix de 5e tour du Lightning de Tampa Bay, bien en forme ce soir-là, qui avait bloqué 55 des 57 tirs canadiens. Shea Weber avait brisé l’égalité en troisième période lors d’un avantage numérique. Le Canada s’en était tiré avec une légère frayeur.

Alex Pietrangelo, Carey Price et Patrice Bergeron avec leurs médailles d'or aux Jeux de Sotchi, en 2014.
Photo : Getty Images / Bruce Bennett
Pour les Russes qui avaient investi tant d’argent dans ces Jeux olympiques – plus de 50 milliards de dollars à l’époque –, la débâcle dans leur sport national avait été difficile à avaler. Le mélodrame avait commencé dès le tour préliminaire lors du match contre les Américains.
Avec un compte de 2-2 au dernier tiers, la Russie s’était fait refuser un but parce que le filet américain avait été préalablement déplacé. La reprise vidéo ne laissait guère de doute, ce qui n’a pas empêché les partisans russes de faire entendre leur mécontentement. Les États-Unis l’avaient emporté en prolongation après coup, compliquant le parcours des Russes, finalement battus en quarts de finale.
Certains partisans avaient même manifesté devant l’ambassade américaine à Moscou. Que de douce ironie quand on sait que ces Jeux ne se sont pas exactement révélés être un modèle d’intégrité sportive et gouvernementale.


 8 hours ago
1
8 hours ago
1











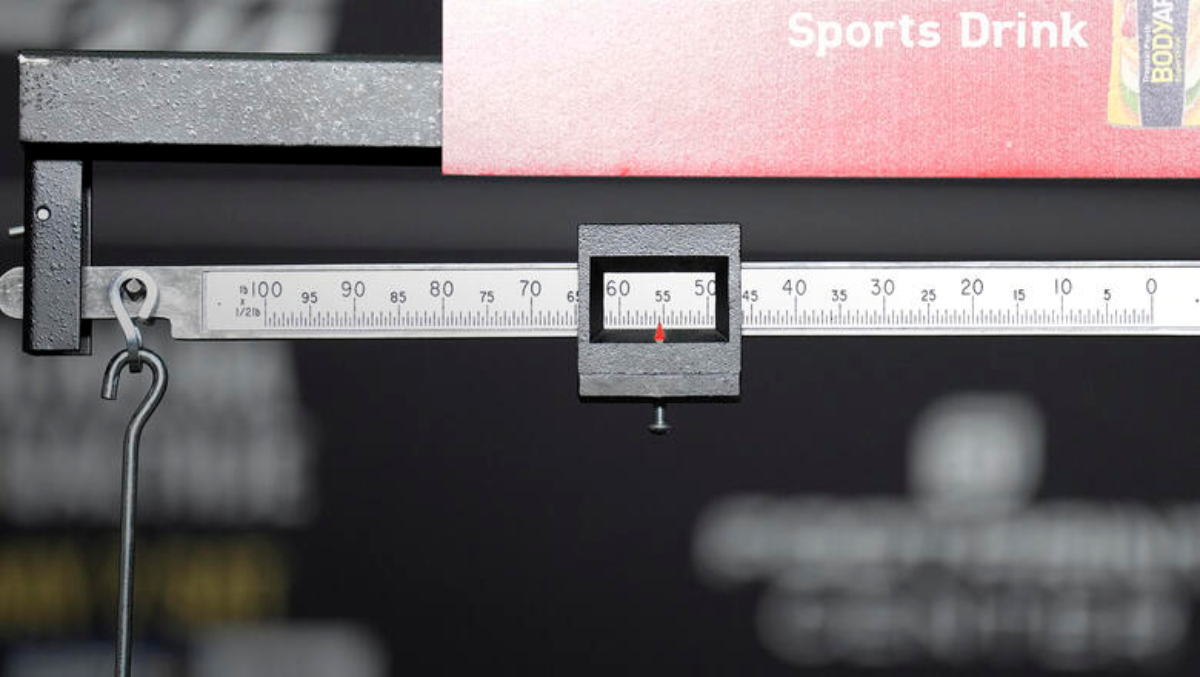




 English (US) ·
English (US) ·  French (CA) ·
French (CA) ·